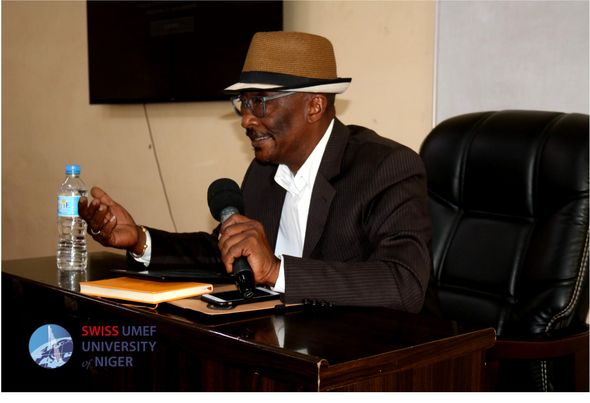
Le ministre Farmo Moumouni
C’est en 2019, alors que je m’affairais à l’écriture de : Repenser la démocratie en Afrique , que j’ai utilisé pour la première fois le terme incolonie. J’ai dû recourir à la création de ce terme pour décrire une situation imaginaire : celle de l’Etat africain qui, ayant été déclaré indépendant après avoir vécu la colonisation, se mettrait dans une situation ou un état tant sur le plan culturel que sur les plans économique, politique et militaire, pour ne pas régresser, pour empêcher toute occupation de son territoire, toute domination et toute recolonisation.
A cette époque, l’incolonie n’était qu’un concept, une idée, une abstraction, une représentation qui ne reposait sur aucune réalité concrète. Je tenais l’incolonie comme une fin, mais aucun Etat africain ne semblait s’être assigné l’incolonie comme objectif ultime. Je voyais l’incolonie comme une mission qui devrait être sinon accomplie, au moins entamée par notre génération intermédiaire entre les pères de l’indépendance et les générations qui montent. Mais, l’opacité, les tâtonnements et hésitations, qui dans la chaîne des générations empêchaient les cohortes 1960-1990 et 1990-2020 d’assumer leurs responsabilités, émoussèrent mes attentes.
L’indépendance véritable et la souveraineté entière sont inhérentes à l’idée d’incolonie. J’avais par ailleurs l’intime conviction que nos peuples et nos Etats qui sont sous domination étrangère depuis six (6) siècles au moins, ne sont pas condamnés à végéter ad vitam aeternam dans cette situation, et qu’un mouvement de fond irrépressible et irréversible était à l’œuvre vers un aboutissement : l’égalité et la liberté. Ensemble, le constat et la conviction eurent raison de mes appréhensions, et je poursuivis ma réflexion.
Trois ans plus tard, en 2022, après avoir procédé à une analyse de la situation qui prévalait au Liptako Gourma caractérisée par une domination française multiforme :
– Politique, avec l’intervention dans les élections locales, la désignation des dirigeants par les réseaux françafricains ;
– Economique, avec la mainmise de la France sur les ressources naturelles des pays du Liptako, la position quasi monopolistique des entreprises françaises dans les secteurs essentiels, l’arrimage de la monnaie au trésor français ;
– Militaire, avec une occupation territoriale et la présence de bases militaires ;
– Une guerre dite contre le terrorisme, qui est en réalité une guerre coloniale ou de recolonisation, et qui, de proche en proche, devient une guerre de libération et d’indépendance ;
– Les répercussions sur le vécu et le mental des populations, les ressentiments et frustrations, les besoins et attentes suscités chez les Etats et les peuples ;
J’écrivais dans Désensorceler l’Afrique. Sens et Devenir que les conditions objectives et psychologiques de l’unité fédérale sont réunies dans le Sahel central, et que les pays qui le composent : le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pourraient constituer le noyau central auquel d’autres pays mus par la nécessité viendraient se joindre.
Le 16 septembre de l’an 2023 (création de l’AES à Bamako) et le 6 juillet 2024 (signature du traité de la Confédération des Etats du Sahel à Niamey), des événements importants pour le Sahel central et pour l’Afrique se sont produits. J’y voyais la continuité entre la théorie et la pratique, la concrétisation de l’idée d’incolonie. Non seulement le noyau fédératif que j’annonçais avait vu le jour, mais il se présenta dès sa naissance comme, porteur de la mission générationnelle qui n’était jusqu’alors qu’un souhait.
Partout, les peuples, comme s’ils avaient enfin pris conscience et compris le sens du nom Liptako donné à cette terre par Brahima Seydou Birmali (celui qu’on ne terrasse pas), comme s’ils avaient entendu et cru au mot de Boubou Hama : « Le pays où reposera ce drapeau sera Liptako, c’est-à-dire invincible et interrassable », se sont redressés, débarrassés des peurs qui les tétanisaient et des complexes qui les handicapaient pour prendre à l’unisson leur destin. Jamais, ni sous le ciel du Niger ni sous les cieux du Mali et du Burkina Faso, on n’avait assisté à une rencontre fusionnelle entre dirigeants et peuples : les uns agissant dans le sens de l’intérêt général avec une vision d’avenir, les autres apportant un soutien inédit aux premiers pour qu’advienne le changement, tous œuvrant pour la liberté, la dignité, l’indépendance et la souveraineté. Partout, pour rompre avec les hégémonies centenaires, les régimes anciens, les soumissions indignes et les habitudes abjectes, la Refondation de la République devint un mot d’ordre.
Désormais, nos cultures refont surface : nous n’avons plus honte de nos coutumes et de nos croyances. Nos langues ne sont plus des dialectes : officielles, elles coexistent avec les langues coloniales, en attendant de les remplacer dans l’enseignement et dans l’administration. Nos rues, nos grand-places et nos monuments qui honoraient l’histoire et la culture des autres, tiennent à présent leurs noms de personnages illustres de chez nous, et d’événements marquants de notre histoire.
Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les richesses placées par Dieu sur le sol et dans le sous-sol, appartiennent aux Burkinabè, aux Maliens, aux Nigériens. Elles sont mises au service du bien-être de nos populations. L’Etat prend le contrôle des entreprises et de l’industrie. Nous sommes maîtres de nos ressources, et décidons de la manière dont nous les exploitons et des fins auxquelles nous les affectons. Aucune main, hormis la nôtre, ne sera mise sur nos mines, nos puits et nos sociétés. Et les temps ne sont pas loin où le CFA, monnaie coloniale, reposera dans les musées.
D’ores et déjà, la rencontre entre les peuples et les leaders de l’AES aseptise la politique et disqualifie les pratiques néfastes :
– Les partis politiques qui ont prouvé, suivant l’expression de Simone Veil, qu’ils sont des « machines à fabriquer de la passion collective », dont le but est non pas d’œuvrer à l’intérêt général, mais de travailler à leur « croissance illimitée », c’est-à-dire pour leurs propres intérêts au détriment de ceux de la nation ;
– La gouvernance kleptocratique, caractéristique majeure des régimes précédents, la fâcheuse propension de se servir des biens de l’Etat comme de son patrimoine, la pratique françafricaine de la politique ;
– La démocratie dévoyée, la démocratie-simulacre, la démocratie-parodie : boulevard reliant l’impérialisme occidental et ses suppôts internes.
Au demeurant, le désaveu du pastichage politique ouvre la voie à des pratiques éclairées, à la création de lois et d’institutions politiques qui tiennent compte des temps et des circonstances dans lesquels nous vivons, et qui s’inspirent de notre culture et de notre histoire.
Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les bases militaires ont été démantelées, les troupes étrangères ont quitté nos pays, l’occupation de notre territoire par les forces occidentales a pris fin. Nos forces confédérales s’illustrent dans la défense de l’intégrité de notre territoire, dans la sécurisation des personnes et de leurs biens, et se sacrifient pour que règne la paix. Le terrorisme, ce mal créé, entretenu et utilisé contre nous, est la dernière arme de l’Occident décadent qui s’accroche, qui se débat et ne peut se faire à l’idée de sa chute prochaine. L’ordre de l’Histoire commande que le déclin succède à l’apogée.
Dans la lutte pour l’indépendance, la liberté et la souveraineté, l’AES a remporté des victoires. Ses forces unifiées gagneront la guerre contre l’impérialisme occidental et le terrorisme, son bras armé. Elles établiront des alliances avec des pays amis, feront appel à la bête noire de nos ennemis : la Russie, et aux autres épouvantails de l’Occident, au besoin. Qui parmi nos ennemis et détracteurs n’a pas adopté cette conduite, lorsque sa liberté, son indépendance, sa souveraineté et son existence étaient menacées ? Nos ennemis sont oublieux ? Qu’ils se souviennent que le Niger, le Burkina et le Mali se sont portés à leur défense, lorsque le nazisme projetait de les anéantir.
A-t-on mesuré suffisamment la portée des événements qui se déroulent au Liptako Gourma, au Sahel central, en AES ? Au-delà des frontières de l’Afrique occidentale, ils affectent tout le continent, hors de celui-ci, ils concernent les Africains et les Afrodescendants vivant en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie.
Ce qui se joue sur nos terres, sous nos cieux, c’est la dignité de l’homme noir, c’est l’émancipation des séquelles des traites négrières, de l’esclavage et de la colonisation, c’est la fin de six siècles de domination et des complexes pluriséculaires d’infériorité, en cette ère d’incolonie inaugurée par l’AES, dans la douleur, au milieu des ruines et des désastres, nonobstant l’hostilité extérieure et les trahisons internes.
Pour l’honneur, L’indépendance, Et la souveraineté, L’AES vaincra.
Farmo M.




