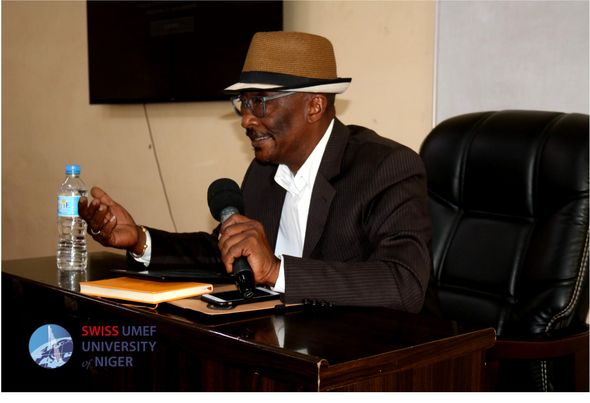M. Chaibou Abou
La commande publique constitue un levier majeur de l’action économique et sociale de l’État, en mobilisant des ressources significatives pour la satisfaction des besoins collectifs et le développement des infrastructures. Au Niger, pays en pleine transition économique et institutionnelle, la réforme de la commande publique s’inscrit dans une dynamique de modernisation visant à renforcer la transparence, la bonne gouvernance et la performance économique des dépenses publiques.
Cette réforme est notamment encadrée par un ensemble normatif combinant les directives communautaires de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la législation nationale – en particulier la Loi n°2011-37 du 28 octobre 2011, portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et les décrets, notamment le Décret n°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022, portant Code des marchés publics et des délégation de service public, qui remplace les cadres réglementaires antérieurs. Ce corpus légal vise à sécuriser les procédures de passation, améliorer la qualité des achats publics et assurer une utilisation efficiente des ressources publiques.
Ce travail se propose d’analyser les évolutions récentes du cadre juridique et réglementaire de la commande publique au Niger, d’évaluer leur impact sur la performance économique et d’identifier les leviers d’amélioration permettant de faire de la commande publique un véritable instrument de transformation économique.
La Loi n°2011-37 du 2 juillet 2011 : un cadre juridique issu de la transposition communautaire, à l’efficacité économique encore limitée
La Loi n°2011-37 portant principes généraux des marchés publics au Niger s’inscrit dans une logique d’harmonisation régionale impulsée par l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Elle constitue une transposition normative des Directives n°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, relative aux procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et N°05/2005/CM/UEMOA, portant sur le contrôle et la régulation de ces mêmes marchés. L’adoption de cette loi marque ainsi la volonté du Niger de se conformer aux standards communautaires en matière de transparence, de concurrence et de bonne gouvernance dans la commande publique.
Sur le plan institutionnel, la loi consacre les principes universels de la commande publique (libre accès à la commande, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures) et institue une régulation autonome à travers la création de l’Autorité de la Régulation de la Commande Publique. Elle clarifie également la chaîne de responsabilité des acteurs, en séparant les fonctions de passation, de régulation et de contrôle a priori. Ce qui constitue un gage d’impartialité dans les procédures, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Directive n°05/2005/CM/UEMOA qui dispose que : « Les Etats membres s’engagent à mettre en place des mécanismes institutionnels et opérationnels de régulation qui ne peuvent pas être dévolus aux entités administratives chargées des fonctions de contrôle des marchés publics et des délégations de service public telles que définies à l’article 4 de la présente Directive ». Ce même principe de séparation des fonctions est transposé à l’article 4 de la Loi n°2011-37 précitée. Autrement dit, en aucun cas les acteurs de la structure en charge du contrôle a priori ne peuvent exécuter une mission des acteurs de la structure en charge de régulation de la commande publique et vice versa.
Cependant, si cette transposition juridique représente une avancée normative notable, son impact économique demeure limité. Conçue essentiellement comme un instrument de conformité administrative, la loi souffre d’un ancrage économique faible. Elle n’intègre pas de dispositifs explicites visant à faire de la commande publique un levier de développement économique, comme la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) nationales, la création d’emplois ou la stimulation de l’innovation. Par ailleurs, la complexité procédurale, la lenteur institutionnelle et l’absence de liens fonctionnels avec les politiques économiques nationales (telles que le PDES) réduisent considérablement son efficacité opérationnelle.
Bien que la Loi n°2011-37 susvisée témoigne d’un alignement réussi sur le droit communautaire, elle reste à ce jour insuffisamment mobilisée comme outil stratégique au service de la performance économique.
Les textes d’application de la Loi n°2011-37, entre consolidation juridique et inertie économique
L’édifice juridique de la commande publique au Niger a été consolidé par une série de textes législatifs et règlementaires d’application adoptés à la suite de la Loi n°2011-37, issue de la transposition des directives communautaires citées plus haut, afin de traduire dans la pratique les principes énoncés par ladite loi. On peut notamment citer :
– la Loi n°2022-46 du 12 décembre 2022, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) ;
– le n°2023-192/PRN/PM du 23 février 2023, portant création, missions et organisation de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires (DGCMPOB) et précisant les attributions des différents responsables ;
– le Décret n°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022, portant Code des marchés publics et des délégations de service public, qui détaille les modalités de passation, d’exécution et de contrôle des marchés.
– le Décret n°2018-496 du 20 juillet 2018, instituant le Code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics ;
– les textes sectoriels et circulaires : un encadrement spécifique encore trop dispersé.
L’ensemble de ces textes constitue un dispositif normatif dense visant à opérationnaliser les principes de la loi mère dans un esprit de régularité, de contrôle rigoureux et de prévention des pratiques corruptives. Ces mesures ont permis d’instaurer une meilleure traçabilité des marchés, d’outiller les acteurs techniques et de clarifier les responsabilités à chaque étape du processus.
Cependant, cette sophistication juridique, bien qu’indispensable à la crédibilité du système, n’intègre que marginalement une logique de performance économique. Les critères d’attribution restent fortement axés sur le moins-disant financier, au détriment de l’analyse en coût global ou de la prise en compte des externalités économiques positives (emplois, innovation locale, développement industriel). En outre, la complexité des procédures et la lourdeur administrative, induites par l’empilement des contrôles, entravent la célérité de l’action publique. Ce qui ralentit l’exécution des projets et l’absorption des crédits d’investissement.
Il faut noter que l’absence de mécanismes incitatifs pour favoriser les entreprises locales, les jeunes entreprises innovantes ou les filières prioritaires limite les effets de la commande publique sur la transformation économique nationale. Ainsi, ces textes, bien qu’efficaces en matière de régulation juridique, ne participent que faiblement à la construction d’une commande publique comme outil de politique publique.
Réformes institutionnelles récentes de la chaine de commande publique:
L’architecture institutionnelle de la commande publique au Niger a connu d’importantes mutations au cours de la dernière décennie, traduisant une volonté politique de renforcer le contrôle, d’améliorer la gestion des finances publiques et d’assurer la régularité des procédures. Deux textes majeurs marquent cette évolution :
De la structure en charge de la régulation de commande publique : vers une régulation plus exhaustive.
La Loi n°2022-46 du 12 décembre 2022 marque une étape décisive en substituant à l’ancienne Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) une nouvelle entité dénommée Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP). Ce changement n’est pas seulement terminologique ; il reflète une volonté d’élargir le périmètre d’intervention de l’organe de régulation à l’ensemble de la commande publique (marchés publics, délégations de service public, contrats de partenariat, achats sur simple facture etc.).
L’ARCOP bénéficie désormais d’un cadre légal renforcé, d’une autonomie accrue et de missions élargies, comprenant notamment : le contrôle a posteriori des procédures de passation, la régulation des litiges et différends, la veille juridique et la normalisation documentaire, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance, le suivi de la performance globale du système de commande publique.
Cette réforme confère à l’ARCOP un rôle central dans la structuration du système national de commande publique. Toutefois, son mandat reste essentiellement régulatoire, avec peu d’interventions directes dans les stratégies de contenu local, de développement industriel ou d’accès préférentiel des PME. Ainsi, sa transformation n’a pas encore été accompagnée d’une reconfiguration des instruments de pilotage économique.
De la structure en charge du contrôle a priori
La DGCMP/OB est placée sous la tutelle du Ministère en charge des finances, dont les attributions sont réorganisées et élargies pour inclure le contrôle a posteriori des marchés publics et la supervision des opérations budgétaires. L’objectif est de garantir une cohérence accrue entre les engagements contractuels et les contraintes de soutenabilité budgétaire, dans une logique d’alignement avec les principes de la budgétisation axée sur les résultats (BAR).
Toutefois, plusieurs limites persistent quant à l’articulation entre ces réformes institutionnelles et les impératifs de performance économique : Premièrement, la DGCMP/OB demeure centrée sur des fonctions de conformité juridique et budgétaire, sans mandat explicite en matière de pilotage économique ou de stratégie de développement industriel. Elle agit comme gardienne des procédures, sans être un acteur de la structuration des chaînes de valeur ou du ciblage des bénéficiaires de la commande publique ; Deuxièmement, les Directions des marchés publics fonctionnent souvent de manière cloisonnée, avec des capacités techniques inégales, des procédures encore manuelles, et une faible intégration des outils de suivi-évaluation de la performance et Enfin, l’absence d’un système intégré de pilotage stratégique, capable de relier planification sectorielle, budget-programmes et stratégie de passation. Cela limite la portée transformative de la commande publique, qui demeure un outil d’exécution administrative plutôt qu’un instrument de politique économique.
Ainsi, si la réforme institutionnelle engagée avec la création de la DGCMPOB constitue une avancée notable vers un meilleur contrôle des marchés publics et des opérations budgétaires, elle ne saurait produire ses pleins effets sans une refonte plus profonde des missions, outils et indicateurs de performance liés à la commande publique.
Le Décret n°2013-002/PRN/PM du 4 janvier 2013, quant à lui, institue les Directions des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DMP-DSP) au sein de chaque ministère. Ces structures en charge de passation des marchés jouent un rôle crucial dans la planification, la préparation et la passation des marchés dans leur domaine de compétence. Elles permettent une meilleure proximité opérationnelle, tout en assurant une remontée d’informations vers les organes centraux de contrôle.
Ces évolutions traduisent une volonté d’ancrer la commande publique dans un système de gestion publique intégrée et modernisée. Le passage d’une logique centralisée à une gouvernance multi-niveaux (ministérielle, régionale, nationale) permet, en théorie, une plus grande efficacité dans la chaîne de passation et un meilleur contrôle de la dépense publique.
(À suivre)
Par Chaibou Abou,
Doctorant en Commande Publique de l’Université Privée Africaine Franco Arabe de Mali, avec comme sujet de recherches : ‘’Commande publique et son impact sur la performance économique au Niger’’