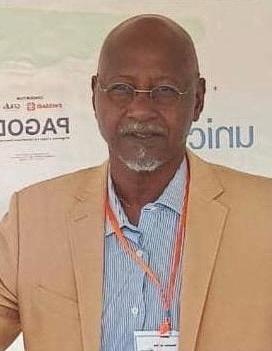M. Chaibou Abou
Une gouvernance de la commande publique renforcée
Dans leur ensemble, ces réformes traduisent une volonté manifeste de professionnaliser, contrôler et sécuriser la commande publique. La réorganisation autour de pôles spécialisés (régulation avec l’ARCOP, contrôle avec la DGCMPOB, planification, passation et exécution avec les DMP/DSP) s’aligne avec les bonnes pratiques internationales en matière de gouvernance publique.
Cependant, le maillon faible demeure l’absence d’une gouvernance économique de la commande publique. Aucun des organes précités n’est mandaté ou outillé pour intégrer dans les procédures : des critères de performance économique (emploi, innovation, industrialisation), des objectifs de contenu local ou de renforcement des capacités nationales, une programmation stratégique des achats publics en lien avec les politiques de développement.
En somme, le Niger a accompli un travail institutionnel important en réformant ses organes de régulation (ARCOP), de contrôle (DGCMP/OB) et de mise en œuvre (DMP/DSP). Ces évolutions permettent une plus grande transparence et une meilleure responsabilisation des acteurs. Néanmoins, tant que la commande publique ne sera pas inscrite dans une stratégie explicite de transformation économique, son potentiel restera sous-exploité. Il devient donc nécessaire d’instituer un cadre de pilotage stratégique de la commande publique, adossé à des politiques de développement endogène.
Le nouveau Code des marchés publics et des délégations de service public (Décret n°2022-743 du 29 septembre 2022)
L’arsenal juridique encadrant la commande publique au Niger a connu, au cours de la dernière décennie, une révision en profondeur, traduisant un effort de modernisation, d’alignement communautaire et de renforcement de la gouvernance publique. Ce décret remplace le Décret n°2016-641 du 1er décembre 2016, et constitue le nouveau cadre de référence régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations de service publics. Adopté dans un contexte de réaffirmation de la rigueur dans la gestion des deniers publics, ce code vise à : renforcer la transparence et l’équité des procédures ; intégrer des innovations procédurales (marchés électroniques, recours accrus aux systèmes d’acquisition dynamiques, etc.) et rationaliser les délais et mécanismes de contrôle.
Ce texte s’inscrit dans la continuité des directives de l’UEMOA, tout en introduisant une volonté de modernisation et de simplification. Toutefois, il reste majoritairement centré sur les aspects juridiques et procéduraux, sans consacrer une stratégie explicite de valorisation économique de la commande publique (ex : clauses de contenu local, préférence nationale encadrée, critères de développement durable ou d’innovation).
Le décret n°2018-496 du 20 juillet 2018 : révision du Code d’éthique et de déontologie
Ce décret remplace celui de 2011, en introduisant des obligations plus rigoureuses à la fois pour les acteurs économiques (candidats, soumissionnaires, titulaires) et les agents publics impliqués dans la chaîne de la commande publique. Il vient réactualiser le socle éthique de la commande publique, en intégrant de nouveaux principes de redevabilité, de prévention des conflits d’intérêts, et de responsabilisation individuelle des agents publics impliqués.
Cette réforme est salutaire au regard des enjeux de lutte contre la corruption et d’amélioration de la qualité de la gouvernance. Toutefois, l’éthique n’est pas encore reliée à une logique d’impact socio-économique. Aucune disposition n’encadre, par exemple, la responsabilité sociale des titulaires de marchés publics, ni l’inclusion économique dans les attributions.
L’analyse de ces dispositions révèle un potentiel stratégique important, bien que sous-exploité, pour assainir le climat des affaires, réduire les asymétries d’information et encourager une concurrence loyale; autant de leviers essentiels à l’amélioration de la performance économique nationale.
L’interdiction des ententes collusoires, de la corruption active ou passive, ainsi que des pratiques anticoncurrentielles, constitue une barrière contre la captation de la commande publique par des groupes oligopolistiques. Cela favorise l’ouverture du marché aux PME, accroît la diversité de l’offre, et donc, stimule l’innovation et la baisse des coûts à long terme.
En outre, dans la Circulaire N°0063/PM du 18 octobre 2024, portant sur l’entente collusoire et le déni de mise en concurrence dans la passation et exécution des marchés publics, le Premier Ministre a rappelé au respect strict par les acteurs de commande publique des dispositions cardinales de ce code d’éthique et de déontologie. En tout état de cause, les contrevenants subiront la rigueur de la loi, comme prévu par la réglementation en vigueur.
Malgré la richesse du cadre éthique instauré par le décret de 2018, plusieurs limites pratiques peuvent en atténuer l’efficacité réelle : Faible institutionnalisation du contrôle éthique, faute de mécanismes de vérification indépendants et de sanctions dissuasives appliquées de manière systématique ; culture administrative encore permissive, marquée par une faible appropriation du texte par les acteurs ; manque de coordination avec les objectifs économiques : l’éthique est encore conçue comme une exigence morale et non comme un levier d’attractivité du marché et d’efficience de la dépense publique.
Ainsi, pour que les règles d’éthique et de déontologie jouent pleinement leur rôle dans l’amélioration de la performance économique de marchés publics, il devient indispensable de : renforcer les mécanismes de contrôle indépendants (audit d’éthique, Brigade de contrôle), articuler l’éthique à la performance, en intégrant des indicateurs d’intégrité dans l’évaluation des marchés, et former les acteurs publics et privés sur les liens entre gouvernance, intégrité et compétitivité économique.
Retenons que le décret n°2018-496, en consacrant des règles d’éthique et de déontologie robustes à l’attention de tous les acteurs de la commande publique, pose les fondations d’un système vertueux où la transparence, la responsabilité et la loyauté deviennent des conditions essentielles de l’accès aux ressources publiques. Toutefois, ce potentiel normatif demeure encore sous-exploité tant que les outils de mise en œuvre, de suivi et de sanction restent faibles. Intégrée dans une stratégie plus large de commande publique orientée vers la performance économique, l’éthique peut devenir un avantage compétitif pour l’État et les entreprises.
En somme, le nouveau Code des marchés publics de 2022, la réorganisation du contrôle avec la DGCMPOB et la mise à jour du cadre éthique en 2018 traduisent une dynamique nationale volontariste de refondation du système de commande publique, dans un esprit de bonne gouvernance, de rigueur budgétaire et de conformité communautaire.
Cependant, cette réforme reste fortement axée sur la régularité procédurale, sans que la commande publique ne soit mobilisée comme outil de transformation économique, d’industrialisation ou de développement des capacités nationales. Le cadre réglementaire nigérien gagnerait à évoluer vers une commande publique stratégique, intégrant des objectifs économiques explicites, notamment par : l’introduction de clauses de performance socio-économique, l’encouragement du contenu local et des chaînes de valeur nationales et la mise en œuvre de dispositifs préférentiels encadrés en faveur des PME nationales.
Les textes sectoriels et circulaires : un encadrement spécifique encore trop dispersé
Parallèlement au dispositif central, plusieurs textes sectoriels (circulaires, arrêtés, guides méthodologiques) visent à adapter la commande publique aux spécificités de certains secteurs (Bâtiments Travaux Publics (BTP), énergies, Technologie de l’Information et de la Communication (TIC), santé, etc.). On peut citer :
– Les manuels de procédures spécifiques pour les projets financés par les bailleurs (Banque Mondiale (BM), Banque Africaine de Développement (BAD), Union Européenne (UE), souvent plus rigoureux mais déconnectés du droit national.
– Les circulaires de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique et de la DGCMPOB, relatives à la planification annuelle des marchés, à la normalisation des documents type, ou aux procédures d’urgence.
– Les textes sectoriels spécifiques de passation ou introduisant des conditions techniques dans certains domaines (infrastructures, santé, éducation).
Ces instruments sont utiles à la gestion opérationnelle, mais ils souffrent d’un manque de cohérence globale et d’une faible interopérabilité avec les textes généraux. Le pilotage reste morcelé, et les liens entre planification sectorielle, allocation budgétaire et stratégies d’achat public demeurent peu institutionnalisés.
L’on retient que si les textes d’application et les instruments sectoriels de la commande publique au Niger permettent une meilleure sécurisation des procédures et une réduction des risques juridiques, ils n’intègrent que faiblement les enjeux de développement économique. Le système reste principalement conçu pour encadrer et contrôler, sans réelle capacité à orienter les dépenses publiques vers les objectifs de transformation économique, d’inclusion des PME ou de compétitivité des filières locales.
L’un des défis majeurs réside donc dans la révision ou l’adaptation de ces textes pour intégrer une logique de budgétisation par résultats, de commande publique stratégique et de développement industriel, à l’instar de ce que préconisent les nouvelles orientations des partenaires techniques et financiers du Niger.
Conclusion
La refonte du dispositif juridique et réglementaire de la commande publique au Niger traduit une volonté affirmée de modernisation, portée par le souci de conformité aux standards de l’UEMOA en matière de transparence, de bonne gouvernance et d’efficacité de la dépense publique. La Loi n°2011-37 et le Décret n°2022-743/PRN/PM en constituent les piliers fondamentaux, complétés par des textes d’application récents tels que le code éthique de 2018.
Cependant, en dépit de cette densification normative, la commande publique demeure enfermée dans une logique de sécurisation formelle des procédures, sans pour autant être pleinement mobilisée comme levier de transformation économique. Les réformes engagées peinent à intégrer des objectifs stratégiques tels que la valorisation du contenu local, la participation accrue des PME ou le soutien à l’industrialisation.
Dans cette perspective, une évolution s’impose : il ne s’agit plus seulement de sécuriser juridiquement les procédures, mais d’aligner la commande publique sur les impératifs de performance économique. L’introduction de clauses à impact socio-économique, de mécanismes préférentiels encadrés et d’une meilleure articulation avec la budgétisation par résultats devient alors cruciale.
En définitive, la consolidation d’un système de commande publique aligné sur les objectifs budgétaires, économiques et sociaux constitue une condition sine qua non pour améliorer durablement la performance publique et promouvoir une croissance inclusive et équitable au Niger.
Par Chaibou Abou
Doctorant en Commande Publique de l’Université Privée Africaine Franco Arabe de Mali, avec comme sujet de recherches : ‘’Commande publique et son impact sur la performance économique au Niger’’