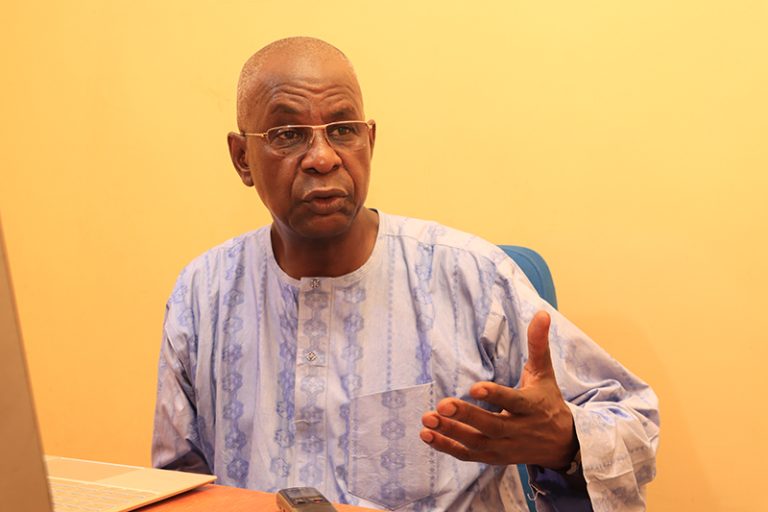Colonel Ali Seydou Moussa
L’utilisation du plomb dans les peintures et les revêtements est à l’origine d’importantes contaminations de l’environnement et de nombreux problèmes de santé. Au Conseil des ministres du vendredi 18 Juillet 2025, le gouvernement a adopté un projet de décret portant réglementation de la teneur du plomb total dans les peintures et les revêtements assimilés afin de limiter leurs conséquences sur l’environnement et la santé. Interrogé sur la question, le Directeur Général de l’Environnement expose les risques liés à l’utilisation de ce type de peinture et en dit davantage sur les mesures prises par le gouvernement pour réglementer la teneur en plomb totale dans la peinture.
Monsieur le Directeur Général de l’Environnement, la question de la teneur du plomb totale dans les peintures et les revêtements assimilés a été abordée au Conseil des ministres du 18 juillet 2025. Quels sont les problèmes environnementaux et les risques sanitaires liés à l’utilisation de ce type de peinture ?
Avant d’apporter une réponse à cette question, il convient tout d’abord de rappeler ce que sont les peintures contenant du plomb, d’identifier les sources de plomb dans ces produits, ainsi que les principales voies d’exposition. La peinture est un mélange composé de résines, de pigments, de charges, de solvants et d’additifs divers. Les composés de plomb y sont ajoutés de manière intentionnelle pour conférer certaines propriétés spécifiques : intensité de la couleur, résistance à la corrosion (notamment sur les surfaces métalliques), et accélération du temps de séchage. Pour les mêmes raisons, on retrouve également des composés de plomb dans d’autres types de revêtements, tels que les vernis, laques, émaux, glaçures ou apprêts.
Ainsi, l’utilisation de composés à base de plomb dans les peintures et revêtements s’explique par leurs caractéristiques chimiques particulières. Il est important de noter que certaines peintures peuvent contenir naturellement du plomb en faibles quantités, mais ce sont surtout les additifs à base de plomb qui entraînent une augmentation significative de la concentration, rendant ces produits potentiellement dangereux.
En ce qui concerne les voies d’exposition, elles se manifestent principalement lors de l’écaillement ou de l’effritement des anciennes peintures au plomb. Ce processus libère des particules fines qui contaminent la poussière domestique et les sols, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations. Ces particules sont facilement ingérées ou inhalées, en particulier par les enfants en bas âge jouant au sol, ainsi que par les travailleurs du bâtiment exposés lors de travaux de rénovation ou de démolition.
Les problèmes liés à l’exposition au plomb peuvent être appréhendés à trois niveaux : sanitaire, environnemental et socio-économique. Sur le plan sanitaire, l’exposition au plomb, même à de faibles concentrations, peut provoquer des effets toxiques graves sur plusieurs systèmes et organes de l’organisme, notamment : le système nerveux central, le système cardiovasculaire, le système digestif, l’appareil génital, le système sanguin, le système rénal et le système immunitaire. Les enfants sont particulièrement vulnérables : une exposition faible peut suffire à entraîner une diminution du quotient intellectuel, des troubles du développement cognitif et du comportement. Chez les femmes enceintes, le plomb peut traverser le placenta, entraînant un retard de croissance intra-utérin, une baisse du poids à la naissance, un risque accru de fausse couche ou d’accouchement prématuré. Chez l’adulte, une exposition prolongée est associée à des risques accrus d’hypertension artérielle, d’insuffisance coronaire et d’autres maladies cardiovasculaires.
Pour ce qui est des conséquences sur l’environnement, le plomb est une substance toxique persistante. Il contamine durablement les sols, les eaux et les écosystèmes, affectant les plantes, les animaux et les micro-organismes, perturbant ainsi les équilibres écologiques.
Enfin, les impacts socio-économiques de l’exposition au plomb sont considérables. Les effets irréversibles sur le développement cérébral des enfants engendrent des pertes importantes en capital humain, en productivité et en revenus futurs. À cela s’ajoutent les coûts liés aux soins médicaux, à l’accompagnement éducatif spécialisé et aux impacts sociaux du handicap mental. Ces charges sont supportées à la fois par les familles touchées et par l’ensemble de la société.
Existe-t-il, avant la prise de ce décret, un ou des textes qui réglementent l’importation et la commercialisation de ce type de produit au Niger ?
Au Niger, le décret adopté lors du Conseil des ministres du 18 juillet 2025 constitue à ce jour le seul texte réglementaire encadrant la teneur en plomb totale dans les peintures et les revêtements assimilés.
Il convient également de rappeler l’existence de la norme nigérienne NN 07-04-001 relative aux peintures et vernis – composition chimique, publiée en août 2024, qui fixe la teneur maximale en plomb à 90 parties par million (ppm). Toutefois, cette norme n’aborde pas les aspects liés à la commercialisation, ni à l’importation de ces produits. C’est donc sur la base de cette norme nationale et en cohérence avec les exigences internationales en matière de santé publique et de protection de l’environnement que le décret a retenu la limite réglementaire de 90 ppm comme seuil autorisé de plomb dans les peintures et revêtements assimilés.
Quel est le pourcentage toléré par les normes sanitaires et la réglementation au plan national et international ?
Comme déjà mentionné, le seuil limite de la teneur en plomb dans les peintures et autres revêtements assimilés au Niger est fixé à 90 parties par million (ppm). Il s’agit du seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ONU-Environnement, en tant que niveau maximal permettant de réduire efficacement les risques sanitaires liés à l’exposition au plomb.
Dans cette dynamique, de nombreux pays à travers le monde se sont également alignés sur ce seuil, reconnu comme la norme internationale de référence.
Le seuil réglementaire de 90 ppm représente ainsi la limite garantissant la meilleure protection de la santé publique, en particulier celle des enfants, contre les effets toxiques des peintures au plomb.
Quels sont les moyens de contrôle dont dispose le Ministère de l’Environnement pour vérifier la teneur de plomb dans les peintures et pour empêcher la mise sur le marché de ces produits ?
Il convient de souligner que le contrôle de la teneur en plomb dans les peintures et revêtements assimilés ne relève pas uniquement des agents du Ministère en charge de l’Environnement. Ce travail implique également la participation d’autres institutions compétentes, notamment les services du Ministère de la Santé, du Ministère du Commerce et de l’Industrie, ainsi que les services des Douanes.
La vérification de la teneur en plomb s’effectue à deux niveaux complémentaires. Le premier niveau, concerne l’examen du dossier de déclaration de conformité. À cette étape, les autorités vérifient les résultats d’analyses physico-chimiques de la peinture, y compris la teneur en plomb, provenant d’un laboratoire agréé. Cette vérification peut également s’appuyer sur une déclaration sous serment du fabricant ou de l’importateur, attestant que le produit est conforme au seuil réglementaire de 90 ppm.
Le deuxième lui, consiste en une contre-analyse menée, le cas échéant, par les services compétents, afin de confirmer la teneur réelle en plomb du produit mis sur le marché. Cette approche multisectorielle et à double niveau vise à garantir la fiabilité du contrôle et à assurer la conformité des produits aux exigences réglementaires en vigueur.
Est-il possible de reconnaître, de manière empirique, ce type de peinture ? Si oui quelles en sont les caractéristiques ?
Il n’existe aucune différence visuelle entre une peinture à forte teneur en plomb et une peinture à faible teneur ou sans plomb. Leur apparence, leur texture ou leur couleur ne permettent pas de les distinguer à l’œil nu.
Seules des analyses en laboratoire ou l’utilisation d’équipements spécifiques de détection permettent d’identifier et de quantifier la teneur en plomb dans ces produits.
Au regard de la dangerosité de ce type de peintures pour les usages quotidiens, quelles sont les actions envisagées par le Ministère pour amener la population à comprendre les risques liés à l’utilisation de ces produits ?
L’étape décisive de ce processus a été franchie avec l’adoption du décret portant réglementation de la teneur en plomb total dans les peintures et les revêtements assimilés. Cette avancée majeure a été rendue possible grâce à la vision éclairée et à l’engagement ferme du Président de la République, le Général d’Armée, Abdourahamane Tiani, Chef de l’Etat ,et du Premier ministre, ministre de l’Économie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, en faveur de la protection de la santé publique et de l’environnement.
Avant l’entrée en vigueur effective du décret, plusieurs actions sont prévues, notamment : la sensibilisation de la population sur les dangers liés à l’utilisation des peintures contenant du plomb, à travers divers canaux de communication. A cela s’ajoute la sensibilisation ciblée des importateurs et fabricants de peinture sur les risques sanitaires et environnementaux, en mettant l’accent sur les importateurs, car la majorité des produits concernés actuellement sur le marché nigérien proviennent de l’extérieur. Il est également prévu, la formation des fabricants sur les techniques de formulation alternatives, en utilisant des ingrédients exempts de plomb. Il convient de préciser que des substituts sûrs et disponibles peuvent être employés pour produire des peintures conformes aux normes, ouvrant ainsi aux entreprises locales l’accès au marché national et régional, où la réglementation sur la teneur en plomb est déjà en vigueur.
À moyen terme aussi, des actions d’identification des sites sensibles, notamment les écoles, ayant potentiellement utilisé des peintures au plomb seront entreprises, suivies de mesures de décontamination. Ces mesures traduisent l’engagement concret de l’État à protéger les populations, en particulier les enfants, contre les effets toxiques du plomb, et à instaurer un environnement sain et sécurisé.
Réalisé par Rahila Tagou (ONEP)