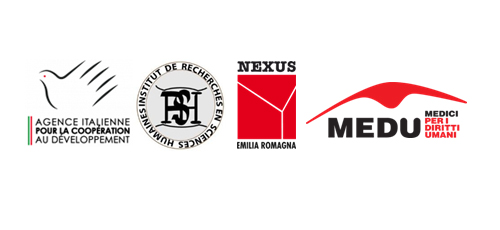
Bulletin d’information N°3, avril 2025
Le mercredi 23 avril 2025, l’Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH) et l’Université du Bien Commun (UBC), en collaboration avec NEXUS Emilia Romagna ont organisé dans le cadre du projet : « Promotion de la coexistence pacifique, de la protection, et de dialogue interreligieux au Niger » (AID 012970/01/4), financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), une conférence publique sur le thème
« L’abrogation de la loi 2015-036 : quel impact sur la libre circulation au Niger ? » à la salle de conférences du Centre d’Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale (CELHTO) de l’Union Africaine.
Une cinquantaine de participants issus de diverses couches socio-professionnelles ont été mobilisés pour débattre de cette question.
Modérée par Dr Issa Abdou YONLIHINZA, Maître de Conférences à la faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), la conférence a été animée autour de trois communications. La première communication a été faite par Professeur Harouna MOUNKAILA, Vice-Recteur de l’université Abdou Moumouni, la seconde par Madame SANI Aissata Garba et la troisième par Père Mauro ARMANINO suivie de deux témoignes : celui de Monsieur Laurent membre du Service Pastoral des Migrants (SPM) et celui de Malcom Muller Sackor migrant refoulé accueilli par le SPM.
Ce bulletin d’information qui est le troisième de la série, retrace d’abord la substance des discours des représentants des organisations partenaires avant de présenter respectivement la teneur des trois communications et celle du public.
La substance des discours des représentants des organismes partenaires
Après le mot de bienvenue du directeur de l’IRSH, Dr Hamadou ISSAKA, Maître de Recherches, Madame ISSAKA Nana Adiza MOUSSA la représentante de NEXUS est intervenue pour saluer la pertinence du sujet traité au regard du contexte actuel de la Confédération des États du Sahel marqué par la sortie du Niger, du Burkina Faso et du Mali, de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) artisane du texte sur la libre circulation des personnes et des biens dans l’ancien espace communautaire. Ils ont salué la présence des participants et remercié le CELHTO pour avoir autorisé la tenue de l’évènement dans sa prestigieuse salle de conférence.
Que faut-il retenir des interventions des trois conférenciers et de celles des deux témoins ?
Le premier Conférencier, Professeur Harouna MOUNKAILA, a rappelé d’entrée de jeu que l’abrogation de la loi 2015-036 sur le trafic illicite des migrants a défrayé l’actualité au Niger puisqu’elle avait été critiquée par les acteurs de la région d’Agadez (responsables coutumiers, opérateurs économiques, société civile et population locale) qui y trouvaient les germes de la destruction des activités économiques locales. Il a ensuite appelé à ne pas oublier que le Niger est à la fois un pays d’accueil, de transit et de départ. Le Niger reçoit actuellement les réfugiés internes et les refoulés de l’espace Sahara-Sahel. Les bailleurs de fonds et les autorités du Niger s’étaient focalisés sur la dimension « espace de transit » du territoire du Niger pour élaborer la loi en 2015. La seconde raison est relative au drame des ressortissants de Kantché qui ont perdu la vie dans le Sahara en tentant de se rendre en Algérie en 2013. Pour l’Union Européenne (UE), l’adoption de cette loi et la vigueur avec laquelle elle avait été appliquée avaient fait du Niger un bon modèle en matière de gestion de la migration internationale. Après cette note introductive, le conférencier, Professeur Harouna MOUNKAILA, a articulé son intervention autour de trois (3) questions :
- Quel contenu donner à la notion de libre circulation ?
- Dans quel contexte la loi a été adoptée ?
- Quel est son impact ?
Pour répondre à la première question, il a rappelé que la libre circulation renvoie à la mobilité qui est, elle-même, une donnée fondamentale des sociétés d’aujourd’hui. Le principe de la libre circulation transcende la souveraineté des États au sens de l’article 13 de la déclaration Universelle des droits de l’Homme de l’ONU de 1948 qui dispose que « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État » et que « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».
La loi 2015-036 adoptée par les autorités du Niger été ainsi une violation des dispositions de cet article 13. Il conclut sur ce point en faisant constater que dans la pratique, il n’y a pas de droit universel à la mobilité, que les individus n’ont pas les mêmes droits et que pour le moment, la libre circulation n’est qu’un idéal difficile à atteindre.
Par rapport au contexte de l’élaboration de la loi, il rappelle que la loi 2015-036 était l’un des instruments fondamentaux adoptés en 2015 pour répondre à une demande sociale de lutte contre la migration. Le Niger a été accompagné dans cette démarche par la Commission de l’UE. Pour le conférencier, c’était un instrument prêt-à-porter qui répondait au protocole de Palerme « visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles ».
Au Niger, cette loi constituait un tournant majeur dans la mesure où la gestion de la migration était marquée par très peu d’intervenants même si, en 1960 et 1990, des protocoles d’accord avaient été signés avec l’Algérie et le Maroc pour gérer la question migratoire.
L’idée de la loi 2015-036 était de contenir le flux de migrants en direction du Maghreb, puis de l’Europe. L’initiative a commencé d’abord au Maghreb, ensuite elle a été réorientée plus au sud, principalement au Niger, le « bon élève », avec la mise en place d’un fonds fiduciaire qui a apporté en 2022, 85 milliards de F CFA au gouvernement de la République du Niger alors que le plan de 2023-2035 prévoyait 503 milliards de F CFA.
Après l’abrogation de la loi 2015-036, une loi de 2013 est reprise pour y intégrer, de manière verticale, un aspect lié au changement climatique, soit une façon vouloir de capter les ressources financières de la communauté internationale. La lutte contre la migration internationale est jugée ainsi comme une rente pour une multitude d’acteurs : étatiques, organisations de la société civile, ONG nationales et étrangères, agents de projets de développement, etc.
En termes d’application de la loi, on a assisté :
- à la sécurisation accrue de la gestion de la migration ;
- au renforcement du contrôle sur les postes : rackettes, refoulements sur fond de « frontrèrisation », concept traduisant l’intensification des refoulements dus aux contrôles excessifs au niveau des frontières. A côté de la gestion traditionnelle des frontières, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a introduit la notion de gestion communautaire des frontières impliquant des organisations qui vont souvent au-delà de leur mandat. La gestion de la migration fait appel à deux notions essentielles : celle de frontière verticale caractérisée par les contrôles traditionnels au niveau des postes de contrôle, et celle de frontières itinérantes où des organisations comme l’OIM mettent en place un dispositif mobile pour enregistrer les flux à partir d’une ligne imaginaire qui repousse chaque fois les frontières plus au sud. La notion de frontières itinérantes suppose ainsi, contrairement à la pratique traditionnelle où c’est l’existence des postes de contrôle qui détermine les mouvements des migrants, que c’est le déplacement des migrants qui détermine des frontières : les migrants ne peuvent pas aller au-delà d’une certaine limite.
Comme indiqué plus haut, l’application de la loi remettait en cause le principe de la libre circulation. Entre 2016 et 2022, le Programme d’Aide aux retours assistés par l’OIM a occasionné le refoulement de plus de 16 000 migrants, nationaux et internationaux sur la base d’un simple accord verbal entre le ministre des Affaires étrangères nigérien et son homologue algérien. De l’avis de beaucoup d’acteurs de la société civile, la manière dont s’opère ces refoulements est assimilée à une déportation.
On retient également de l’application de la loi, une tentative de reconversion des acteurs de la migration : en 2022, au titre de l’application de ladite loi, 700 « criminels » (passeurs, transporteurs et locataires de ghettos) ont été arrêtés, conduisant ainsi à la reconversion professionnelle de beaucoup d’acteurs de la migration.
Du point de l’impact de l’abrogation de la loi 2015-036, troisième axe de l’intervention de Pr Harouna MOUNKAILA, on retient que l’abrogation de la loi répond à deux enjeux : enjeu de politique intérieure et enjeu de politique extérieure.
D’un point de vue de la politique intérieure, il fallait satisfaire à une demande sociale, celle des acteurs de la migration qui ont souffert de la ruine de l’économie de la migration : transporteurs, guides, locataires de ghettos, restaurateurs, etc. D’un point de vue de la politique extérieure, l’enjeu est de satisfaire un discours du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) centré sur l’affirmation de la souveraineté nationale.
Avec l’abrogation de la loi, la libre circulation reprend ses droits même si les flux demeurent timides soit parce que les migrants ont pris d’autres destinations (la Côte atlantique), soit parce qu’ils continuent d’emprunter les voies de contournements qu’ils utilisaient au moment de l’application de la loi.
Malgré l’abrogation, les refoulements continuent et l’engorgement des centres d’accueil constitue toujours un sérieux problème pour l’OIM : plus de 1500 personnes continuent de squatter les quartiers au niveau de la ville d’Agadez, les rackets sur les routes persistent au niveau des postes de contrôles, sur les routes et les frontières d’États.
Après l’intervention de Pr Harouna MOUNKAILA, la deuxième Communication a été faite par Madame Sani Aissatou Garba, qui a parlé au nom du Réseau Migration Développement Droits Humains (REMIDDH). Sur la base des résultats d’enquêtes réalisées en septembre 2023 par plusieurs organismes partenaires, elle informe que la première conséquence de l’abrogation de la loi 2015-036 fut la restitution des véhicules de transport des migrants de marque HILUX à leurs propriétaires, ce qui n’était guère envisageable au moment où la loi était en vigueur. Elle a rappelé l’intervention du Maire d’Agadez pour qui, sa ville qui était avant l’adoption de la loi une ville d’entrée, était devenue une prison à ciel ouvert avec l’application de la loi.
L’abrogation de cette loi est ainsi source d’espoir pour les militants des syndicats, les transporteurs et les opérateurs économiques de la ville. Elle marque la fin des interpellations des locataires de ghettos, des transporteurs et des guides. Tous ces acteurs ont retrouvé leurs activités économiques initiales. Elle a rappelé que la ville d’Agadez est le lieu de transit privilégié des migrants. Elle informe que depuis l’abrogation de la loi, chaque mardi, un convoi quitte Agadez pour Dirkou permettant une traçabilité des déplacements contrairement au moment de l’application de la loi où les migrants empruntaient des voies de contournement mal maîtrisées par les autorités.
L’abrogation de la loi permet de voyager à découvert. Elle rappelle que les réponses apportées permettent d’influencer les flux migratoires avec une maîtrise des sorties : 43% des déplacements sont orientés vers la Libye et l’Algérie.
Elle reste par contre dubitative par rapport à l’efficacité de la reprise de la loi de 2013 et au relent souverainiste des autorités qui attendent beaucoup des organismes internationaux pour financer leur politique de lutte migratoire. De quels moyens dispose le Niger pour mettre en œuvre sa politique migratoire ?
La troisième communication, celle de Père Mauro ARMANINO suivie de deux témoignages, met l’accent sur l’absence des valeurs d’humanisme dans la gestion de la migration. Il rappelle qu’en 2024, 9 000 personnes ont perdu la vie sur les frontières du monde et que la frontière la plus mortelle est celle de la Méditerranée. Il donne l’exemple d’Ousmane Sylla, ce jeune guinéen de 22 ans qui s’est donné la mort dans un centre de détention à Rome en Italie et qui, dans sa dernière volonté, avait demandé de rapatrier son corps en Afrique. Il déplore le fait que les centres de détention en Europe soient des prisons où les candidats à la migration sont détenus durant 18 mois.
Il dénonce également le caractère discriminatoire de la politique migratoire de l’UE dans la délivrance des visas où les pays les plus ciblés sont l’Algérie et le Nigeria pour lesquels le taux de refus atteint 30%. Il dénonce l’arrogance qui est devenue le propre de l’Occident. Pour lui qui a passé une bonne partie de sa vie hors de son pays d’origine, l’Italie, il y a deux regards que l’on peut avoir du migrant : le regard de vérité porté par le pauvre et le regard de liberté qui anime celui qui veut explorer le monde.
Il en déduit que chaque migrant a sa migration car les motivations ne sont pas les mêmes. Par conséquent, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, dans le même bateau. Il soutient que vivre c’est migrer. L’humain est un migrant par nature.
Chaque fois qu’on parle de migrant, il faut se poser la question suivante : Qui parle de la migration et d’où en parle-t-il ? Le regard sur la migration et le migrant dépend de celui qui en parle et d’où il en parle. S’appuyant sur le rapport de l’OIM de 2024, il renseigne que dans le monde, 281 millions de migrants sont dans la mobilité, ce qui dénote de l’ampleur de l’exclusion, de la fracture sociale. Dans la gestion de la migration, il y a une dimension économique et politique qu’il ne faut pas perdre de vue. La migration est toujours un déracinement, ce qui signifie que l’on peut vivre ailleurs.
En ce qui concerne la notion de frontière, il a rappelé que le migrant est toujours un passeur de frontières. C’est un inventeur de frontières comme l’a évoqué le premier conférencier dans sa référence à la notion de frontière itinérante. Il propose ainsi de parler de « pontière » au lieu de frontière. Il fustige la notion de clandestin et d’illégal qu’il assimile à de la stigmatisation du migrant. Il fait remarquer que c’est le pouvoir qui définit les mots et leurs sens. Ces notions ne sont qu’un système d’apartheid qui amène Donald Trump à comparer les migrants sudaméricains, asiatiques et africains à des animaux.
Il montre également l’attitude paradoxale des autorités d’Italie qui appuient la politique migratoire de l’UE alors que pendant un siècle, 28 millions d’Italiens ont migré en France, Suisse, Allemagne et en particulier les États Unis et l’Argentine. Il considère que la politique migratoire de l’Occident est une guerre néocoloniale qui permet de maîtriser les gens partout où ils se trouvent. La migration résiste au système, elle est là pour dire « je ne vais pas disparaître ». C’est un cri prophétique. En terminant son intervention, il rappelle que la migration fait partie du monde. Elle constitue un défi pour la civilisation humaine. C’est sur ces mots qu’il invite Messieurs Laurent et Malcom Muller Sackor à venir témoigner.
Dans son témoignage, Monsieur Laurent précise que malgré l’abrogation de la loi, les migrants attendent toujours, ils ont besoin de vivre. Il présente les interventions du mouvement pastoral où il exerce. Ce service est né en 2011 pour accompagner les migrants qui ont de multiples besoins. Il met l’accent sur l’écoute : ces migrants, hommes et femmes, n’ont pas pour destination le Niger, ils sont en transit.
Par conséquent, ils ont besoin d’un accompagnement alimentaire et d’un accompagnement en vêtements. Ils se trouvent au niveau des ronds-points et des gares routières. Il faut les accueillir sans préjugés. Ils sont déracinés et ont besoin, au-delà du soutien, d’être écoutés. Il précise que son témoignage ne vise pas à encourager les migrants mais à aider à créer un cadre pour les accueillir dignement, avec respect. Pour certains migrants refoulés, Niamey est un terrain de réflexion : certains arrivent à rebondir, d’autres sombrent dans le désarroi.
Ce témoignage est suivi de celui de Malcom Muller Sackor, un migrant ressortissant du Libéria qui a quitté son pays natal depuis 9 ans. Il est maintenant au Niger depuis 5 ans après un séjour en Algérie, puis en Libye et un retour en Algérie. Après avoir quitté le Libéria, il avait transité par la Côte d’Ivoire avec l’intention de continuer en Espagne. Il est resté 1 an en Algérie où il a exercé dans la maçonnerie. Puis il est allé en Libye où il a travaillé pendant 6 mois dans la cueillette des fruits. De la Libye, sa tentative d’aller en Europe avait échoué. Il retourna en Algérie comme clandestin, puis il est retourné à Agadez dans le centre d’accueil des réfugiés. Ce retour volontaire (pour rebondir) semble être mal vécu par Monsieur Malcom qui interprète ce choix en ces termes : « les gens créent eux-mêmes leur propres prisons ». Il trouve que malgré l’abrogation de la loi, les conditions sur la route restent toujours difficiles en raison des tracasseries administratives et des rackets. Il a par contre salué les efforts du service pastoral qui se présente comme l’avocat des autres migrants.
A la suite des deux témoignages, la parole fut donnée aux participants.
Parole des participants
Le premier participant fut le Représentant du Coordonnateur du Centre d’Études Linguistiques et Historiques par tradition Orale (CELHTO) Monsieur Benjamin GNALEGA qui a salué la pertinence de thème de la conférence. Il a remercié les organisateurs et s’est félicité du fait que cette conférence se déroule dans la salle de conférences du CELHTO, organisation de l’Union africaine dont la revue a dédié un numéro à la migration.
Il a rappelé une phrase célèbre du Pape François décédé le 21 avril 2025 et qui avait fustigé la politique migratoire de l’UE en disant « on a fait de la Méditerranée le plus grand cimetière du monde ». Pour le Représentant du Coordonnateur de l’UE, la solution au problème migratoire, c’est de conscientiser les décideurs à adapter des politiques d’insertion des jeunes.
Les autres participants ont posé des questions et apporté quelques contributions. Parmi les questions, on peut retenir les suivantes :
Qu’est-ce qui a motivé les autorités qui avaient précédé le CNSP à prendre cette loi et à l’appliquer en violation des textes de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens ? L’UE n’a-t-elle pas souhaité cette loi à l’image de celle élaborée au Maghreb ? Quelle est la politique migratoire du Niger ?
Après l’abrogation de la loi, parmi les flux en direction d’Agadez, quelle est la proportion de migrants qui quittent pour le Maghreb ?
Quelles mesures peut-on adopter pour favoriser une prise de conscience des activités migratoires ? Quels sont les types de réponses que l’on peut apporter aux migrants laissés à eux-mêmes ? Est-ce que la révision de la loi de 2013 a pris en compte le nouveau contexte de l’AES ?
Les commentaires rejoignent les réponses apportées par les conférenciers qui reconnaissent la pression exercée sur les autorités nigériennes de l’époque par la Commission de l’UE. Dans les commentaires comme dans les réponses apportées par les conférenciers, il ressort que l’abrogation n’a pas entraîné une massification des flux migratoires en raison des phénomènes de contournement et du changement des destinations des migrants.
En ce qui concerne la question relative à la révision de la loi de 2013, il ressort des réponses apportées par les conférenciers qu’il ne s’agit pas d’une révision mais d’une reprise de la loi de 2013 pour y adjoindre de façon mécanique une dimension changement climatique. Là encore cet ajout se justifie par la stratégie de captation des ressources de Communauté internationale par les autorités étatiques.
En conclusion, on peut retenir que tout le monde est unanime sur le caractère exogène de la loi, sur le fait que les résultats attendus de son abrogation sont timides même si les acteurs de la ville d’Agadez continuent de garder espoir quant à une éventuelle reprise des activités économiques locales. Participants et conférenciers sont également unanimes sur le manque de réalisme des autorités qui veulent élaborer une politique migratoire souveraine en comptant sur les bailleurs de fonds pour son financement.
Professeur Abdou Bontianti
Directeur de Recherches
Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH), Université Abdou Moumouni
Cette publication a été réalisée avec la contribution de l’Agence Italienne pour la
Coopération au Développement. Le contenu de cette publication est exclusif responsabilité de
Nexus ER ETS et ne représente pas nécessairement le point de vue de l’Agence




