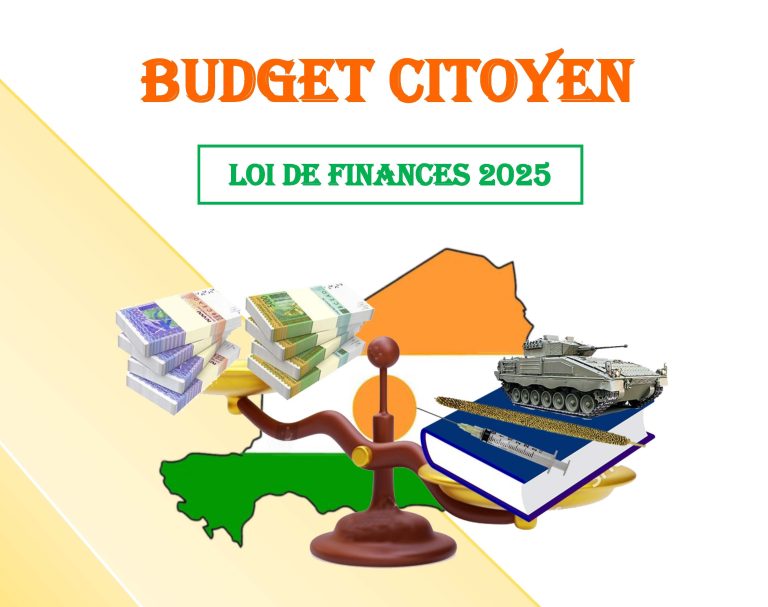M. Sani Magori, cinéaste nigérien
Magori, plus d’un siècle après le passage de la colonne française au Niger, pourquoi avez-vous décidé de réaliser un film sur cette histoire ?
Réaliser ce film est pour moi une manière de mettre en lumière cette page sombre de notre histoire, souvent négligée ou effacée des récits officiels. Les récents événements de 2023, où les Nigériens ont exigé et obtenu le départ des forces françaises, montrent que les blessures du passé sont toujours présentes. Ce film concerne en réalité tous les massacres commis sur tout le territoire du Niger. Mais j’ai choisi le site de Konni parce que c’est l’épicentre du massacre perpétré par la Mission Afrique Centrale qui a pillé, dévasté, incendié, violé et emporté des milliers d’âmes nigériennes sur son chemin infernal.
En effet, peu de Nigériens connaissent ce qui s’est passé à Konni et dans d’autres localités du pays parce que la France a voulu cacher ses exactions. Que s’est-il réellement passé ?
Dès son entrée sur le territoire nigérien par Sansané Haoussa en janvier 1899, la Mission Afrique Centrale conduite par Voulet et Chanoine a commencé par exécuter une centaine de personnes. Ils ont pris tout ce qui pouvait servir (habits, nourritures, animaux, ustensiles, etc.), laissant les habitants nus avec des cadavres et des blessés. À Djounjou, Lougou, Tibiri, Koren Kalgo, Tessaoua, Maijirgui, les massacres étaient horribles.
Le 2 mai 1899, la Mission est arrivée aux portes de ce qu’ils appelaient le « Bourg de Birni N’Konni ». Face au refus de la population d’obtempérer aux ordres de leur donner les vaches et des porteurs, la mission a ouvert le feu sur la muraille de Konni avec une douzaine de coups de canon. Après la prise de la ville en trois jours de combat inédit, les témoignages des officiers français sont édifiants :
Le Sergent Laury, un des membres de la Mission, racontait : « Il suffisait de pousser une porte du pied pour se trouver devant un vieillard en longue robe blanche… Un coup de sabre ou de baïonnette et il tombait… Les gosses, on les tuait à coups de crosse. On sortait les femmes dans la cour. Et si on en avait envie, c’était le moment. On les écartait, l’affaire était faite ! Les autres, on les saignait comme des brebis. Les hommes, ivres de sang et d’enthousiasme, étaient épuisés. Toute la colonne de combat avait disparu dans la ville et se donnait du bon temps… ». Il poursuit : « On fit asseoir cinq à six mille prisonniers au soleil, en attendant de les trier. On dressa un enclos au bord du fossé. Puis un autre encore, plus petit, pour les femmes. Le soir, on «dépucela» toutes les femmes. Cette fois, l’honneur en revient aux artilleurs qui l’avaient bien mérité… On fit ripaille… Tard dans la nuit, on vit des tirailleurs ivres morts, vautrés dans leur butin. Le lendemain, il fallut dégager les cadavres des ruines, des cours et des rues. Il fallut cinq jours pour venir à bout de cette tâche macabre… Une terrible chaleur régnait sur la ville. L’odeur était infecte. On jeta les cadavres pêle-mêle dans les fossés, avant de les recouvrir de terre. Sept ou huit mille cadavres, on ne savait plus très bien… Le 15 mai, quatre corvées détruisirent toutes les cases et les magasins à mil… Le 23 mai, le sergent major Laury fit mettre le feu aux cases et aux magasins. »
Quand la mission quitta Birni N’Konni le 24 mai 1899 après trois semaines de siège, selon leurs archives, environ 12 000 habitants ont été massacrés, 700 femmes ont été triées et emportées. Cette ville de plus de 20 000 habitants, autrefois prospère et décrite comme une taupinière avec des maisons fraîches et propres, des logements pour les femmes, des bains, des serviteurs, des écuries, des greniers pleins de bonnes choses, avait cessé d’exister.
Avez-vous eu suffisamment de témoignages, de traces et autres sources nécessaires pour réaliser ce film sur cette sombre page du passage de la colonne française qu’on a voulu effacer de la mémoire des Nigériens ?
Oui, malgré l’amnésie imposée pendant plus d’un siècle, il existe encore des témoignages, des traces et des archives militaires qui documentent ces événements. Parmi les contributions majeures, des chercheurs nigériens comme le professeur Djibo Hamani, le PhD Mamoudou Djibo, Mr Ibrahim Yahaya auteur du livre L’expédition coloniale Voulet-Chanoine dans les livres et à l’écran et aussi le Professeur Farmo Moumouni, auteur de L’Odyssée d’un tirailleur, ont exploré et documenté ces faits. Leur travail académique constitue une base précieuse pour redonner vie à ces récits. Par ailleurs, des habitants de Konni et leurs descendants, déterminés à briser le silence et à réhabiliter la mémoire de leurs ancêtres, m’ont confié des archives familiales, notamment des récits oraux, des photos et des documents conservés dans leur cercle intime. Ces témoignages personnels complètent les traces officielles. Depuis 2015, je travaille avec le producteur britannique Rob Lemkin, avec qui j’ai coproduit le film African Apocalypse. Ensemble, nous avons exploré les archives nationales françaises d’Aix-en-Provence, où nous avons découvert une mine d’informations : des journaux de bord de militaires français, des photographies, des correspondances et des rapports sur la mission Voulet-Chanoine. Ces documents témoignent de la planification et de l’exécution systématique des massacres.
Nous avons aussi mis la main sur des éléments physiques qui font écho à cette histoire, comme des balles utilisées lors du massacre de Koren Kalgo, le journal du lieutenant Pallier, ainsi que des traités coloniaux de 1904 et 1906. Ces derniers révèlent que le territoire de Konni, alors sous contrôle anglais, a été cédé à la France en échange d’un port de pêche au Canada, soulignant l’indifférence des puissances coloniales à l’égard des populations locales.
Enfin, lors de nos voyages sur la RN1 en 2015 et 2019, nous avons recueilli des témoignages vivants des habitants des zones touchées par la mission. Nous disposons également d’un enregistrement audio exceptionnel d’un tirailleur qui avait assisté au massacre de Konni en 1899, un témoignage qui constitue une pièce maîtresse de notre travail. Toutes ces ressources combinées permettent de recréer une image fidèle de cette page sombre de notre histoire et d’honorer la mémoire des victimes, tout en rétablissant une vérité longtemps occultée.
Quel est l’objectif final que vous visez à travers ce film ?
L’objectif principal de ce film est d’exhumer l’histoire de la colonne Voulet Chanoine en la racontant cette fois-ci du point de vue des Nigériens. Il s’agit de sensibiliser le public à l’impact durable de la colonisation et de promouvoir une justice éthique, permettant aux familles des victimes de mieux comprendre ce qui s’est réellement passé et d’exprimer leurs désirs de justice. Ce film vise à éclairer les faits historiques pour que nous puissions construire une base solide pour un avenir où de telles injustices ne se répéteront plus. Ce film appelle aussi les peuples africains à ne pas se laisser manipuler et à ne pas s’utiliser les uns contre les autres dans des guerres et conflits fomentés par les puissances impérialistes. Dans la Mission Voulet et Chanoine, il n’y avait que 8 officiers français. Les autres étaient des tirailleurs africains enrôlés dans l’armée française. Actuellement, le Niger se bat sur tous les fronts pour sa souveraineté et je compte apporter ma contribution pour réécrire cette histoire détachée du joug colonial. Exhumer les atrocités du colonisateur peut aider à mieux comprendre pourquoi les Nigériens se sont battus pour réclamer le départ des armées occidentales qui ont une sombre histoire aussi bien dans le passé que dans les faits actuels.
Quelles sont les collaborations, si elles existent, que vous avez mises en place dans le cadre de la réalisation de votre film ?
Pour réaliser ce film, je collabore avec des historiens nigériens, des experts en matière de justice transitionnelle et des organisations locales et internationales. Ces collaborations nous ont permis de réunir une documentation riche et variée pour donner vie à ce projet.
Vous êtes actuellement à quelle étape dans la réalisation de ce film et quelle est la date probable de sa sortie ?
Nous sommes actuellement en phase de développement du projet. J’ai consulté plusieurs acteurs nigériens, notamment le ministre de la Culture et celui de la Justice. J’ai la collaboration du Gouverneur de Tahoua à qui nous avons rendu une visite officielle, ainsi que du préfet de Birni N’Konni. Pour cette première phase de développement qui a été bouclée, nous avons eu le soutien logistique d’IMAN Communication et le soutien financier de la SONIDEP.
L’ONEP, la Direction Générale des Douanes sont aussi des partenaires engagés pour soutenir ce projet de film et nous allons leur assurer une visibilité en on et en off du film, témoigner de leur combat patriotique. Actuellement, nous cherchons des appuis des institutions nigériennes pour poursuivre la production de ce film dont tous les piliers historiques et techniques sont à point. Si le gouvernement du Niger s’approprie le financement du projet, nous espérons pouvoir sortir le film en 2025, pour coïncider avec le 126e anniversaire du massacre de Konni.
Quels sont les arguments historiques et les instruments juridiques qui favorisent votre quête de justice pour le peuple nigérien face à la France, ce pays qui ne reconnaît toujours pas ces crimes commis par sa propre Mission ?
Je m’appuie sur le mécanisme de la justice transitionnelle des Nations Unies qui permet d’exhumer et de juger des crimes contre l’humanité qui ont été commis à une époque où les lois n’existaient pas. Nous avons des preuves que ces massacres ne sont juste pas « la responsabilité de deux capitaines rebelles atteints de la soudaineté », mais le résultat d’une volonté de la France d’effrayer les populations pour les contraindre à obéir aux institutions coloniales qu’elle s’apprêtait à installer sur le futur territoire du Niger. Le spectre de cette force française a hanté la mémoire collective des Nigériens jusqu’au mois de décembre 2023, lorsque les Nigériens ont réclamé le départ de ces forces militaires. Voulet et Chanoine avaient auparavant commis des massacres sur la population Mossi. Et c’est donc en pleine connaissance de leur dangerosité que la France leur a confié cette mission en Afrique centrale, avec moins de moyens financiers mais beaucoup de munitions, leur ordonnant de « vivre sur le pays » ; c’est-à-dire de piller pour vivre. La Mission Voulet était directement aux ordres du Ministère français de la Guerre, dirigé par le père de Julien Chanoine. Tous les faits montrent que la France n’a pas envoyé le Colonel Klobb pour arrêter Voulet et Chanoine à cause des massacres commis, mais parce que la mission mettait trop de temps à arriver au rendez-vous du Lac Tchad. Même après la « mort » de Voulet et de Chanoine, la mission et les massacres ont continué à l’aller comme au retour du Lac Tchad. La mise à mort de ces deux capitaines par les tirailleurs était considérée par une large majorité des Français comme une mise en scène. En 1923, Robert de Lavignette, administrateur français à Tessaoua, a discrètement fait exhumer les deux tombes et les a trouvées vides. « Il n’y avait que des boutons de capitaines ! » écrivit-il dans son rapport. Ce rapport a inspiré des œuvres littéraires et cinématographiques. Un mythe raconte que Chanoine serait l’émir blanc qui, en 1916-1917, a aidé l’armée française à capturer et à tuer Kaocen.
Propos recueillis par Siradji Sanda (ONEP)