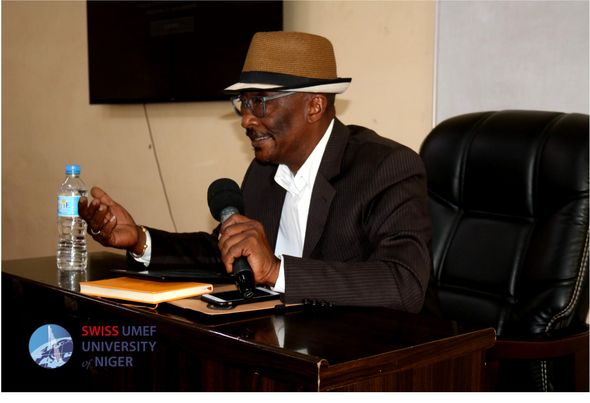Chaibou Abou
RISQUES LIES AUX INTERVENTIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES
Les opérateurs économiques constituent des partenaires incontournables dans la mise en œuvre de la commande publique. Leur participation aux appels d’offres et leur rôle dans l’exécution des marchés conditionnent directement la performance du système. Toutefois, leurs interventions sont susceptibles de générer divers risques, qui affectent la régularité des procédures et la qualité des prestations attendues.
- Risques liés à la soumission des offres : Lors de la phase de soumission, certains candidats adoptent des comportements opportunistes tels que la présentation de dossiers incomplets, la falsification de documents administratifs ou financiers, ou encore la sous-estimation volontaire des prix pour remporter le marché. Ces pratiques, contraires aux dispositions du Code de 2022, fragilisent la sincérité de la concurrence et exposent les projets à des risques d’inexécution.
- Risques liés à la collusion et aux ententes illicites : Un danger récurrent est celui des ententes entre soumissionnaires, consistant à coordonner les offres pour fausser la concurrence. Cette collusion, souvent difficile à détecter, conduit à une hausse artificielle des prix, réduisant ainsi l’efficience de la dépense publique et violant le principe de libre concurrence garanti par l’article 8 du Code de 2022.
- Risques liés à l’exécution des marchés : Une fois le marché attribué, l’opérateur économique peut faillir à ses obligations contractuelles : retards dans l’exécution, abandon de chantier, malfaçons, non-conformité des fournitures ou des services. Ces pratiques entraînent une perte de qualité, un gaspillage des ressources et compromettent la durabilité des investissements publics. Le recours excessif à la sous-traitance non autorisée constitue également une source de risque, en diluant les responsabilités et en fragilisant le suivi technique.
- Risques financiers et de défaillance économique : La fragilité financière de certains attributaires, notamment les petites et moyennes entreprises locales, constitue un facteur de risque majeur. L’absence de capacité de trésorerie ou de garanties suffisantes peut conduire à l’incapacité d’exécuter le marché, entraînant résiliations, retards et surcoûts pour l’État.
- Risques liés aux contestations et aux recours abusifs : Les recours introduits par les soumissionnaires évincés représentent un mécanisme légitime de contrôle. Toutefois, certains opérateurs en font un usage abusif, multipliant les contestations infondées pour bloquer la procédure ou retarder l’attribution. Ces pratiques dilatoires compromettent la célérité des projets et réduisent la confiance dans le système de recours.
En somme, les interventions des opérateurs économiques, bien qu’indispensables, comportent des risques systémiques allant de la soumission des offres à l’exécution effective des prestations. Leur gestion exige un renforcement des mécanismes de vérification documentaire, un contrôle accru de l’exécution des marchés et l’application rigoureuse des sanctions prévues par le Code des marchés publics et les clauses contractuelles. La prévention de ces dérives est une condition essentielle pour transformer la commande publique en levier de performance et de développement durable.
LES DEFIS ET PERSPECTIVES DE LA PERFORMANCE DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU NIGER A TRAVERS LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
L’analyse des risques qui jalonnent le cycle de passation et d’exécution des marchés publics révèle que la performance de la commande publique au Niger reste entravée par de multiples vulnérabilités structurelles, institutionnelles et comportementales. Ces défis concernent non seulement l’administration publique et les organes de contrôle, mais également les opérateurs économiques, dont la participation et les pratiques influencent directement la qualité et l’efficacité des projets publics.
A). Les principaux défis de la commande publique au Niger
L’analyse de la cartographie des risques tout au long du cycle de passation et d’exécution des marchés publics met en évidence un ensemble de défis structurels et opérationnels qui entravent la performance du système. Ces défis, bien que variés, convergent tous vers une même problématique : la difficulté d’inscrire la commande publique dans une logique de performance économique et de bonne gouvernance.
- Défi de la planification et de la prévision. Malgré l’obligation légale d’élaborer un Plan prévisionnel annuel de passation des marchés (PPM), ce dernier demeure souvent incomplet, incohérent avec les plans d’engagement et de trésorerie, et parfois élaboré tardivement. Ces insuffisances compromettent la programmation des projets et créent des blocages en amont de la dépense publique.
- Suppression de la DRP et unification des procédures simplifiées : La procédure de DRP, prévue à l’article 51 du décret, s’avère inadaptée aux marchés de travaux. Il est recommandé de la supprimer et d’unifier les procédures simplifiées autour de la Demande de Cotation (DC), avec un seuil élargi de 15 à 70 millions F CFA, afin de réduire les délais et de favoriser l’accès des PME, conformément à l’article 8 du décret.
- Lourdeur de la DRP pour les marchés de travaux : Le formalisme de la DRP, comparable à celui d’un appel d’offres, freine l’exécution rapide des petits marchés publics et entraîne des retards, voire des annulations. Une unification des procédures autour de la DC est donc nécessaire, conformément au principe de proportionnalité du décret.
- Rigidité des seuils et surcharge du contrôle politique : La fixation du seuil de communication au Conseil des ministres à 300 millions F CFA (article 13 de l’Arrêté n° 18) impose un contrôle politique préalable sur de nombreux marchés, y compris ceux à portée limitée, ce qui ralentit la procédure de passation. Cette centralisation excessive contredit les principes de décentralisation et d’autonomie consacrés par le Décret n° 2022 743. Elle engorge en outre l’agenda du gouvernement, au détriment de l’efficacité et de la réactivité de l’action contractuelle.
- Défi de la transparence et de la concurrence. La publicité et l’accès équitable aux procédures demeurent limités, notamment dans les zones rurales, ce qui réduit la participation des opérateurs économiques et entretient des pratiques restrictives.
- Défi du contrôle et de la redevabilité. Bien que des contrôles a priori et des contrôles a posteriori soient prévus, leur efficacité reste affaiblie par le manque de moyens humains, financiers et logistiques des organes de contrôle et de régulation. La culture de la reddition de comptes n’est pas encore suffisamment ancrée dans les pratiques.
- Défi des capacités institutionnelles. Les acteurs publics (ordonnateurs, contrôleurs financiers, comptables, commissions ad’hoc de marchés) souffrent d’un déficit de formation continue, de maîtrise des outils numériques et de méthodologies harmonisées. Ces lacunes affectent directement la qualité de la gestion des marchés publics.
- Défi lié aux interventions des opérateurs économiques. Certains soumissionnaires adoptent des comportements déviants tels que la soumission de dossiers incomplets ou falsifiés, la collusion, la sous-traitance abusive ou l’exécution défaillante. De telles pratiques augmentent les coûts, dégradent la qualité des prestations et fragilisent la confiance dans le système.
- Défi de sensibilisation et de professionnalisation des opérateurs économiques. Beaucoup d’entreprises locales participent aux appels d’offres sans maîtriser suffisamment les procédures, ce qui se traduit par des offres non conformes, des erreurs techniques et des difficultés dans l’exécution. L’absence d’actions de sensibilisation sur le Code des marchés publics accroît les risques d’irrégularités.
- Défi technologique et de dématérialisation. L’usage des plateformes électroniques reste limité et le retard dans la généralisation de la commande publique électronique freine la transparence, la traçabilité et la célérité des procédures.
Enfin, l’efficacité de la commande publique repose largement sur la qualité de l’intervention des acteurs au sein des autorités contractantes. Or, cette responsabilité se heurte à des contraintes telles que le manque de maîtrise des textes, la faible coordination interne entre services techniques et financiers, ainsi que l’insuffisance de responsabilisation et de traçabilité. Ces limites conditionnent la performance globale du système et entretiennent des risques de conflits d’intérêts et de pratiques opportunistes.
B). PERSPECTIVES D’AMELIORATION DU SYSTEME DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU NIGER
Face à ces multiples défis, il apparaît nécessaire d’ouvrir des perspectives de réforme ambitieuses, capables de consolider la transparence, l’efficacité et la performance économique de la commande publique. Ces perspectives constituent autant de leviers stratégiques pour renforcer la gouvernance et l’impact de la dépense publique.
Renforcer la planification intégrée. L’harmonisation du PPM avec le plan d’engagement et le plan de trésorerie est indispensable pour assurer une cohérence entre programmation budgétaire et exécution des marchés publics, mais également pour garantir la disponibilité effective des crédits au moment du paiement, réduisant ainsi les retards structurels.
- Accélérer la dématérialisation. La généralisation de l’usage des plateformes électroniques pour la publication, la passation, le suivi des marchés publics et la gestion des paiements doit être promue afin de garantir la transparence, la traçabilité et la réduction des délais de règlement.
- Améliorer la transparence et la concurrence. La publication systématique des PPM, des avis d’appel d’offres, des résultats d’attribution, des rapports d’exécution ainsi que des délais moyens de paiement sur des plateformes accessibles, y compris aux acteurs locaux et régionaux, constitue un impératif de gouvernance.
- Professionnaliser les acteurs publics et privés. Des programmes de formation continue et de certification doivent être instaurés au profit des autorités contractantes et des opérateurs économiques, afin de renforcer leur capacité à préparer des offres conformes, à exécuter efficacement les marchés et à maîtriser les règles de gestion des pénalités et des intérêts moratoires.
- Sensibiliser les opérateurs économiques. La vulgarisation du Code des marchés publics à travers des guides pratiques, des ateliers régionaux et des campagnes d’information est essentielle pour promouvoir une participation responsable et compétitive, tout en informant les entreprises de leurs droits en matière de paiement, de pénalités et d’intérêts moratoires.
- Renforcer les organes de contrôle et de régulation. L’ARCOP, la Cour des comptes et les inspections sectorielles doivent être dotées de ressources humaines, financières et technologiques adaptées pour mener un contrôle rigoureux, allant au-delà de la simple conformité pour s’intéresser aussi à la régularité et à la célérité des paiements, ainsi qu’à l’impact économique et social des projets.
- Appliquer rigoureusement les sanctions. L’effectivité des sanctions contre les comportements déviants des opérateurs économiques (collusion, falsification, inexécution), mais aussi l’application automatique des pénalités de retard et des intérêts moratoires en cas de retard de paiement de l’État, sont un préalable à la restauration de la confiance et à la crédibilité du système.
- Instaurer une culture de performance et de redevabilité. L’introduction d’indicateurs de performance mesurables pour évaluer la commande publique – incluant le respect des délais de paiement – assortie de l’obligation de publication des résultats et de l’implication des citoyens dans le suivi, constituerait un levier puissant de transparence.
- Relèvement du seuil de communication au Conseil des ministres : Porter le seuil fixé à 300 millions F CFA par l’article 13 de l’Arrêté n° 18/PM/ARCOP à 700 millions F CFA permettrait de réserver l’intervention du Conseil des ministres aux marchés d’importance stratégique, conformément à l’article 1er du décret. Ce relèvement favoriserait une plus grande autonomie dans la gestion courante des ministères et réduirait les lenteurs administratives.
- Communication a posteriori à titre informatif : La communication au Conseil des ministres devrait intervenir après l’adoption du marché, uniquement à des fins d’information. Cette réforme, qui respecte les principes de transparence et de redevabilité, permettrait d’éliminer les blocages procéduraux et de renforcer la compétence décentralisée des Personnes Responsables des Marchés Publics, conformément au Décret n° 2022 743.
- Adapter le cadre juridique. Enfin, l’actualisation des textes doit intégrer les exigences de la commande publique durable (critères sociaux et environnementaux), renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption, encadrer les recours abusifs des opérateurs économiques et consolider les dispositifs relatifs aux paiements, afin d’assurer discipline et équité contractuelle.
La cartographie des risques tout au long du cycle de passation des marchés publics révèle que la performance de la commande publique au Niger reste fragilisée par des défaillances à la fois techniques, institutionnelles et procédurales. Chaque étape comporte des vulnérabilités qui, cumulées, réduisent l’efficacité et l’efficience de la dépense publique. Les perspectives identifiées s’inscrivent dans une dynamique de réforme structurelle, visant à instaurer un système plus transparent, efficace et résilient, au service du développement économique. En intégrant les réformes proposées – notamment la planification intégrée, la dématérialisation et l’application effective des sanctions, l’État nigérien peut transformer la commande publique en un instrument stratégique de performance économique et de développement durable.
Par Chaibou Abou, Doctorant en Commande Publique de l’Université Privée Africaine Franco Arabe de Mali, avec comme sujet de recherches : « Performance de la commande publique au Niger »