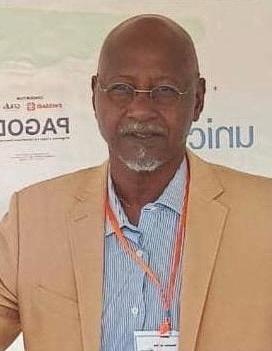
M. Assouman Hassoumi
Introduction
À première vue, changer la part du capital d’une entreprise de 99 % à 100 % (ou inversement) peut sembler anecdotique. Après tout, détenir 99 % ou 100 % du capital, est-ce vraiment différent ? L’exemple récent de la NIGELEC, la Société Nigérienne d’Électricité, montre que ce petit pourcentage peut en réalité porter un symbole puissant, ouvrir des marges d’action nouvelles et traduire une vision de la souveraineté nationale. Décryptage.
- Une SA de droit privé, mais à vocation publique
La NIGELEC existe sous la forme d’une Société Anonyme (SA), conformément au droit OHADA des sociétés commerciales. Ce statut lui donne :
- Une structure de gestion de droit privé (conseil d’administration, direction générale, capital social) ;
- Des obligations comptables et de performance similaires à celles d’une entreprise classique.
- Une possibilité, en théorie, d’ouverture du capital à des actionnaires tiers ou des partenaires privés.
Bref, ce statut lui donne une vocation à faire des bénéfices et à distribuer des dividendes.
Mais en pratique, la NIGELEC a toujours assumé une mission de service public : garantir l’accès à l’électricité sur tout le territoire nigérien, y compris dans des zones rurales peu rentables.
- Pourquoi l’État détenait « seulement » 99 % ?
Historiquement, il subsistait une fraction symbolique du capital entre des mains tierces : institutions parapubliques, parts héritées de l’histoire, voire quelques actions individuelles. Cette situation est fréquente dans les ex-sociétés d’État transformées en SA dans les années 1990-2000 pour moderniser leur gouvernance.
Ce 1 % « résiduel » ne pesait pas en pratique sur les décisions. Mais il entretenait un flou juridique :
- Qui détient quoi exactement ?
- Quelles obligations vis-à-vis de ces petits actionnaires ?
- Quelle est la véritable nature de l’entreprise ?
- De 99 % à 100 % : un symbole de souveraineté
En 2025, le Niger a décidé de porter la détention du capital de la NIGELEC à 100 % public. Cette nationalisation totale clarifie plusieurs points :
- Affirmation du contrôle total de l’État
L’électricité est un secteur stratégique. Détenir 100 % du capital signifie : aucune influence extérieure, aucune part symbolique entre des mains privées. L’État assume seul la responsabilité et la gouvernance.
- Message politique et souveraineté énergétique
Dans un contexte régional marqué par la volonté de reprendre le contrôle des ressources et infrastructures stratégiques, ce geste est un signal fort : l’énergie appartient à la Nation.
- Facilitation des réformes
Avec 100 % du capital, plus besoin de justifier des réformes ou des décisions auprès de petits actionnaires minoritaires. L’État peut restructurer, fusionner, scinder ou ouvrir ponctuellement des partenariats dans la production — tout en gardant la maîtrise.
- Un levier pour la performance et la modernisation
Cette nationalisation intégrale ne change pas la forme juridique : la NIGELEC reste une SA, régie par le droit privé. Mais elle ouvre la voie à :
- Une réorganisation interne plus souple
- La mise en place de contrats de performance entre l’État et l’entreprise
- Une meilleure lisibilité pour les bailleurs internationaux qui financent les grands projets d’électrification rurale ou de transition énergétique.
- Ce 1 % de différence : un petit pourcentage, une grande portée
En apparence, passer de 99 % à 100 % n’affecte pas la gestion quotidienne : le gouvernement contrôlait déjà la quasi-totalité des décisions. Mais symboliquement et juridiquement, ce 1 % est une frontière :
- En dessous de 100 % : l’État est majoritaire, mais partage (un tout petit peu) la propriété.
- À 100 % : l’État devient propriétaire exclusif. L’entreprise devient un outil totalement aligné avec l’intérêt général et la souveraineté nationale.
Conclusion
Oui, un simple pourcentage peut changer la nature d’une entreprise. Pas sa nature juridique — la NIGELEC reste une SA — mais sa nature stratégique et politique.
En assumant 100 % du capital, l’État du Niger montre qu’il veut faire de l’électricité un levier de développement maîtrisé, accessible à tous, et piloté sans contrainte extérieure.
Reste maintenant à transformer ce symbole en résultats concrets : réseau modernisé, pertes techniques réduites, qualité de service renforcée, tarifs soutenables. Là se joue la véritable réussite de cette réforme.
Assouman Hassoumi,
Docteur en Administration des Affaires, Consultant, formateur




